Article publié le 22 mai 2025
Le microbiote intestinal exerce une véritable influence sur diverses fonctions physiologiques. S’il joue un rôle essentiel dans la digestion, l’immunité et la santé mentale, il a également une incidence sur la fonction rénale. Comment module-t-il le bon fonctionnement des reins ? Explications.
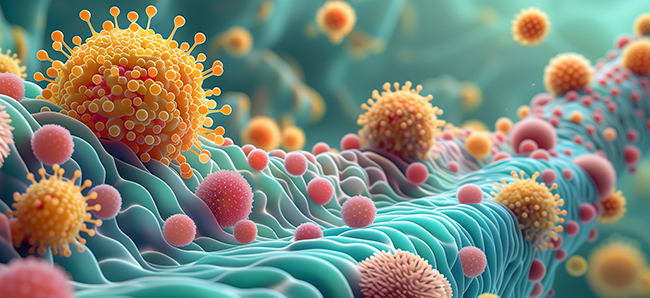
Qu’est-ce-que le microbiote intestinal ?
Chaque personne dispose d’un microbiote ou plus communément, d’une « flore intestinale » unique, constituée de nombreux types de micro-organismes. Il est principalement localisé dans l’intestin grêle et le côlon, réparti entre la lumière du tube digestif et le biofilm protecteur formé par le mucus intestinal qui recouvre sa paroi intérieure. C’est d’ailleurs le microbiote le plus important du corps.
Il se compose à la fois des bons et de mauvais micro-organismes :
- Les bons micro-organismes nous maintiennent en bonne santé en éliminant les mauvaises bactéries. Ils nous aident à digérer en participant à la synthèse de certaines vitamines dans le corps. Ils contribuent également à nous protéger des agents pathogènes contenus dans la nourriture ou les boissons potentiellement contaminées.
- Les mauvais micro-organismes tels que les virus qui infectent les bactéries (appelés « phages ») sont aussi très nombreux au sein du microbiote. Ils peuvent modifier les populations bactériennes, leur patrimoine génétique et l’expression de ce dernier et favoriser les problèmes de santé. Ce sont notamment le Clostridium perfringens, le Staphylococcus et l’Escherichia coli (E. coli), etc.
Plusieurs facteurs influencent la composition du microbiote intestinal :
- La génétique ;
- L’environnement ;
- L’activité physique ;
- L’alimentation ;
- Le tabagisme ;
- La prise de médicaments.
Lorsque le microbiote intestinal est perturbé, on parle alors de « dysbiose ». Ce déséquilibre modifie la paroi intestinale et favorise le passage de molécules provoquant de l’inflammation dans la circulation sanguine. Par ailleurs, la fermentation bactérienne de certains macronutriments peut engendrer la production de toxines urémiques. Ces dernières exercent leurs actions biologiques via l’induction d’un état inflammatoire et d’un stress oxydatif entraînant des effets néfastes. Ces différents mécanismes favorisent alors une altération de la fonction rénale.
De façon générale, le moindre déséquilibre du microbiote intestinal peut altérer notre santé et favoriser le développement de diverses pathologies telles que l’obésité, le cancer, le diabète, le syndrome du côlon irritable, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales.
Quel lien entre le microbiote intestinal et les reins ?
Le lien entre le microbiote intestinal et les reins s’articule autour de plusieurs mécanismes clés :
- La modulation du système immunitaire. Le microbiote régule les réponses inflammatoires systémiques qui peuvent affecter la fonction rénale. Une dysbiose (déséquilibre du microbiote) peut augmenter l’inflammation chronique, contribuant à l’apparition de lésions rénales.
- La régulation de la pression artérielle. Certaines bactéries intestinales influencent la pression artérielle via la production de composés vasoactifs. Cela peut impacter la filtration glomérulaire rénale, une fonction essentielle de chaque néphron qui assure, avec les fonctions tubulaires, la formation de l’urine à partir du plasma.
- L’effet sur la barrière intestinale. Un microbiote déséquilibré peut compromettre l’intégrité de la barrière intestinale, permettant la translocation de toxines et de bactéries dans la circulation sanguine, atteignant ensuite les reins.
- L’axe intestin-reins bidirectionnel. Les dysfonctionnements rénaux peuvent à leur tour perturber le microbiote, créant un cercle vicieux où les toxines urémiques modifient la composition bactérienne intestinale.
L’incidence du microbiote sur la fonction rénale fait l’objet de travaux de recherche
À Nancy, Sandra Wagner, épidémiologiste, étudie notamment les liens entre la composition de notre microbiote, l’alimentation et leur impact sur la progression de la maladie rénale chronique dans un projet innovant nommé « CKD MICROBIOME ». Ces travaux précurseurs menés en association étroite avec le Centre de recherche en Épidémiologie et en Santé des Populations de Villejuif, sont subventionnés par l’Agence nationale de la recherche.
Un projet de recherche pour mieux comprendre l’interaction microbiote-alimentation
Selon elle « un des problèmes majeurs dans la maladie rénale chronique est le défaut d’élimination des déchets appelés toxines urémiques. En temps normal, ces dernières sont éliminées par les reins, mais chez les malades, elles s’accumulent dans l’organisme et participent à la progression de la maladie, à l’inflammation et à d’autres complications ».
C’est le microbiote qui, en jouant son rôle fondamental dans la digestion, produit la plupart de ces toxines à partir de composants alimentaires.
Objectif : identifier les microbes associés à la progression de la maladie
Elle cherche à montrer que le régime alimentaire d’un individu joue un rôle important sur la concentration sanguine de ces toxines. Son objectif est donc d’identifier les caractéristiques du microbiote intestinal associées à une surproduction de toxines urémiques et à une progression plus rapide de la maladie rénale chronique. Ce projet s’appuie sur un sous-échantillon de 240 patients de la cohorte CKD-REIN, avec un recueil simultané d’échantillons de sang et de selles, deux fois à trois ans d’intervalle, ainsi que des données sur l’alimentation. De l’ADN a été extrait de ces collectes afin de déterminer la présence et l’abondance de chaque espèce microbienne et leur fonctionnalité pour tous les échantillons.
« Nous avons obtenu des résultats préliminaires prometteurs, avec des différences significatives de composition du microbiote entre malades et population saine et selon le niveau de fonction rénale. Nous avons pu observer que les patients avec un niveau de fonction rénale plus altéré avaient un microbiote enrichi en espèces bactériennes ayant une enzyme impliquée dans la production de toxines urémiques » explique-t-elle.
Ces premiers éléments montrent que les patients atteints d’une maladie rénale chronique ont un microbiote altéré, d’autant plus quand les patients sont à un stade avancé.
Sources :
- https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=filtration%20glom%C3%A9rulaire
- https://www.academie-medecine.fr/role-des-toxines-uremiques-dans-la-genese-des-complications-de-la-maladie-renale-chronique/
- https://anr.fr/Projet-ANR-19-CE17-0023
- https://www.inserm.fr/dossier/microbiote-intestinal-flore-intestinale/
- https://www.inserm.fr/actualite/ckd-microbiome-quand-le-microbiote-influe-sur-la-sante-de-nos-reins/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007996022001183
- https://www.frm.org/fr/maladies/recherches-autres-maladies/microbiote-intestinal/focus-microbiote-intestinal
- https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=m%C3%A9tabolite



