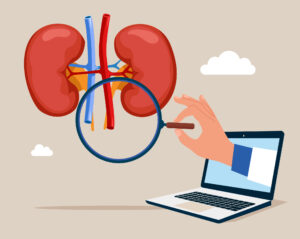Interview publié le 18 Mars 2025

IA générative et néphrologie
Dr Jean-René Larue, néphrologue, président d’IA & Néphrologie 2025
Vous organisez les 20 et 21 novembre la 3ᵉ conférence IA et néphrologie. Pourriez-vous nous rappeler ce qu’est l’IA générative ?
L’IA générative repose sur les Large Language Models (LLM). Ce sont des modèles entraînés sur un vaste corpus de textes et conçus pour prédire, sur des bases probabilistes, le mot suivant dans une phrase. En 2019, une publication a mis en avant la technique des Transformers — le « T » de GPT — permettant de créer un LLM capable de mieux prendre en compte le contexte en faisant émerger le sens du texte et contribuer à limiter ce que l’on appelle les « hallucinations ». Un point décisif, car en santé, ces erreurs posent de réels problèmes.
Les LLM généralistes ne sont pas entraînés sur des données médicales et scientifiques, il n’est pas possible de leur faire confiance pour des informations médicales très précises. Mais des LLM spécialisés, destinés aux professionnels de santé, sont désormais entraînés à partir de données de haute qualité, et ont accès à des articles scientifiques et des revues médicales. Ces avancées permettent donc au domaine de la santé, et en particulier à la néphrologie, de s’emparer de l’IA. Les enjeux sont tels que ce serait une grave erreur de les ignorer.
Nous voyons également émerger l’IA agentique, une nouvelle forme d’IA générative. Dans ce cas, le LLM sollicite différents agents spécialisés qui vont travailler de façon autonome, et qui lui renvoient leurs résultats afin de co-construire une réponse plus pertinente, et cela par exemple à partir des données d’un logiciel métier.
Quelles sont les IA pertinentes en santé ?
Le site américain OpenEvidence est déjà utilisé chaque jour par plusieurs dizaines de milliers de médecins et par 10 000 hôpitaux aux États-Unis. OpenEvidence s’appuie sur des articles et des données issus notamment du New England Journal of Medicine, du Journal of the American Medical Association (JAMA), de la base de données PubMed du National Institutes of Health ainsi que de la base de données de la Mayo Clinic.
En France, une société bordelaise aborde une démarche similaire : MedGPT, elle utilise comme références les données de la Haute autorité de santé (HAS) ainsi que celles de l’Union européenne.
Ces plateformes spécialisées reposent sur la technique de la Retrieval Augmented Generation (RAG). Concrètement, le LLM sert d’intermédiaire : il pose la question, puis construit la réponse à partir de bases de données connues, identifiées et, en l’occurrence, issues de revues scientifiques de qualité.
Comment utiliser l’IA en santé et en néphrologie ?
Les usages de l’IA en santé sont multiples. Pour la recherche bibliographique, par exemple, PubMed IA permet d’accéder à l’ensemble des données scientifiques à partir de mots-clés, mais aussi d’exploiter le résultat de la recherche avec de l’IA.
Au quotidien, la technique du speech-to-text est déjà largement employée pour dicter des courriers. Dans le secteur médical, de nombreux praticiens utilisent Medical One. Par ailleurs, les systèmes dits d’Ambient Listening se développent : Nabla et Doctolib proposent désormais des logiciels capables d’enregistrer les conversations durant la consultation et de fournir des synthèses automatiques.
Pour le traitement et la synthèse de documents, y compris médicaux, Notebook LM offre des résumés intelligents, compréhensibles et exploitables sous diverses formes : compte rendu, carte mentale, article, audio, etc.
En France, le logiciel Arkhn Assistant, spécifiquement dédié à la santé, fonctionne de manière totalement sécurisée (hébergeur de données de santé agréé). Il génère des synthèses telles que des comptes rendus d’hospitalisation de jour, des bilans pré-transplantation ou encore des suivis post-transplantation. Le néphrologue n’a qu’à valider le texte, sachant qu’en un clic il peut retrouver non seulement le document source mais aussi l’endroit exact où figure l’information pour vérifier son exactitude.
L’IA peut également contribuer à l’éducation thérapeutique des patients via des chatbots, notamment en néphrologie, avec des outils performants dans le domaine de la nutrition. Elle est aussi devenue incontournable pour la définition et le suivi de protocoles de recherche, la gestion administrative et la recherche instantanée de la bonne information au bon moment au sein de la base documentaire de l’établissement.
Nous devons collectivement réfléchir à l’usage de l’IA en santé et en néphrologie. Son développement étant inéluctable, il ne faut pas la combattre mais l’accompagner afin d’éviter l’émergence d’« utilisateurs fantômes ». Des solutions techniques existent déjà : il s’agit désormais de les mettre en œuvre. Pour cela, il faut s’y intéresser, se former et former les collaborateurs — médecins, personnels soignants et patients. L’acculturation à ces technologies représente un travail considérable.
Les conférences des 20 et 21 novembre seront l’occasion de faire le point avec des spécialistes de ces questions et de bénéficier du retour d’expérience du CHU de Montpellier, déjà engagé dans l’intégration de solutions d’IA.